
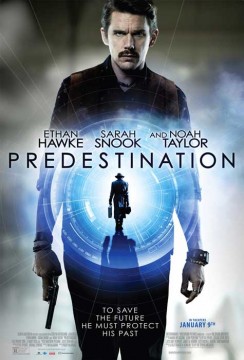
J’ai vu récemment Prédestination, le film de Michael et Peter Spiering sorti en 2014. Ça sent l’adaptation d’un roman de SF, et ça tombe bien car ça l’est, le scénar est tiré d’une nouvelle de Robert A. Heinlein : All You Zombies.
C’est une histoire bien tordue, jouant avec le paradoxe temporel. J’aime bien les scénars tordus mais j’avoue que là, par moment, j’ai été un peu largué. L’affaire doit être plus explicite en bouquin ; en film, si tu expliques tout, ça devient lourdissime. Ce film ne l’est pas, il est même plutôt bon, mais comme il évite la lourdeur, il te paume (volontairement ?) par moment. Ce qui m’a un rien gêné, c’est le putain de trou dans le scénario, un trou que j’ai pour ma part un peu de mal à avaler. Qu’est-ce qu’un trou dans un scénario ?

Si l’on se réfère à Robert McKee, un des papes des scénaristes (le scénario est une religion où l’on peut avoir plusieurs papes), un trou est un illogisme, ou un énorme anachronisme. Dans une série cinéma culte – que j’adore -, Terminator, tout repose sur un trou monstrueux : le chef de la résistance contre les machines du futur envoie son bras droit dans le passé et c’est ce bras droit qui, couchant avec sa mère (très beau gosse, le bras droit, faut dire), va l’enfanter lui, chef de la future résistance.

Dès que vous avez une machine à remonter le temps sous la main, essayez donc un peu pour voir. Ça ne marche pas. C’est impossible dans notre linéarité temporelle connue, c’est donc ce qu’on appelle allégrement – et pour justifier l’impossible – un paradoxe temporel. Comme dit Robert McKee (qui vante par ailleurs la qualité du film et de son scénario) : « Le trou de Terminator n’est plus un trou, c’est un abîme. » Mais bon, on prend ça pour ce que c’est, un postulat, on l’accepte, on avale, et on suit le film sans problèmes.
Je suis moins enthousiaste sur le paradoxe temporel version Prédestination car tout le film tourne autour de ça, à savoir que le héros s’auto-engendre, il couche avec lui-même et se fabrique donc lui-même. Il faut voir les circonvolutions du script pour en arriver jusque-là. Mais bon, une fois qu’on a émis ces réserves, ça reste un film honorable (moins drôle que Retour vers le futur mais tout le monde n’est pas Zemeckis).
A partir de là, on peut s’interroger sur la nôtre, de prédestination. Comme dans prédestination, il y a sérieusement le mot destin – vous aviez remarqué -, il faut croire au destin. Ou pas. Moi je n’y crois pas. Pour moi, le destin, c’est un peu comme la chance : on modèle son destin, on fabrique sa chance. Il n’empêche que la prédestination, ça peut nous travailler l’esprit. Quel est le but de notre jeu, le nôtre perso, qu’est-ce qu’on est venu faire entre vie, mort et coiffure, pour reprendre la synthèse de Coluche ?
Car au départ rien n’est clair, et ensuite tout se complique. On va éviter le mot Dieu, qui ne met personne d’accord, pour plutôt retenir la terminologie de Spinoza (qui a d’ailleurs renoncé lui aussi à mettre tout le monde d’accord) : la Nature.
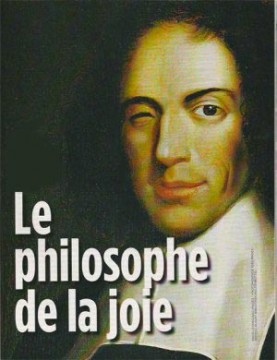
La Nature est quand même un rien salope, perverse, ou alors elle a un sens de l’humour hyper développé. T’arrive sur terre, déjà t’es bigleux, ça ne va s’éclaircir que progressivement ; tu comprends pas la langue des aliens qui t’entourent, mais comme ils ont l’air plutôt sympa, tu vas faire un effort de plusieurs années pour parler leur dialecte imprononçable. Là, on parle du gosse joyeusement attendu dans une famille, pas de celui accouchant sur un trottoir de Bogota parmi les rats et condamné à les bouffer. Celui-là, respect, il a du mérite. S’il s’en sort.
Donc la Nature te balance à poil et dans un univers tenant du no man’s land. Tu crois qu’elle te filerait un minimum de mode d’emploi, un manuel ? Que dalle. Bonjour le SAV de la Nature. Quant à la hot line pour te plaindre, balle-peau, tu vas mettre des années et une tripotée de religions pour t’apercevoir au final que Dieu n’a pas le téléphone, on lui a pas installé pour la bonne raison qu’il n’a aucun domicile connu, d’aucuns pensent même qu’il n’existe pas, c’est vous dire le SAV…

C’est un peu comme si tu sautais en parachute, sans armes ni bagages, parfois sans parachute (pour ceux de Bogota), et que tu atterrisses au milieu d’un nulle part qui s’appelle même pas Kolwezi, à poil donc et sans aucune consigne sur la marche à suivre. Tu sens, instinctivement, que t’as une mission, mais on a juste oublié de te dire laquelle. Démerde-toi Jojo, avance, tu vas pas nous emmerder avec des détails.

Je n’y connais rien en jeux vidéo, pas ma génération et la plupart de ceux-ci m’inquiètent car ils nous préparent à la Troisième (guerre mondiale, pour les comprenettes difficilettes), mais sans y connaître rien, je suis sûr que des jeux sans règles existent*, le but du jeu étant de justement découvrir ses règles. C’est comme la vie. Au départ, y a aucunes règles, elles ne se révèlent que progressivement, en cours de jeu. (* Interrogé sur la question – autant demander à des spécialistes -, mon fils Hugo dit que le jeu vidéo proche de ce que j’évoque ici s’appelle flOw.)

Après, il faut que tu te positionnes dans ce grand bordel de jeu. Histoire de s’appuyer sur quelque chose dans cet univers de sable, tu as des pulsions, des envies, étayées par l’innée, guidées par l’acquit. Mais notre grand jeu vie-déo, semé de chausse-trappes sinon c’est pas drôle, n’en a rien à foutre de tes désirs. Prenons l’exemple du mec, un peu bipolaire quand même, qui veut être messie. Tout le prédestine à être charpentier. Va falloir qu’il bosse sérieux pour arriver à ses fins, l’aura intérêt à jouer des coudes et à avoir de la tchatche pour convaincre tout le monde, et accessoirement lui-même. Dans l’exemple de ce gars, tout s’est bien terminé ; pas pour lui, certes, qui n’a pas connu le succès de son entreprise, mais il a tout de même fondé une multinationale.

Je vais prendre un autre exemple, celui d’un type que j’aime bien, que je crois connaître tout en m’en défiant un peu : moi. Quand j’ai treize ans, m’arrive la puberté accompagnée de deux choses : une peur d’hémorragie à la bite et, sans aucun rapport à priori, une pulsion d’écriture. Ce que j’imagine être une hémorragie vient d’un excès de branlette dans le dortoir des sixièmes du collège de Juilly ; à force de me « tirer sur l’élastique » (selon la formule imagée d’un copain), je sens soudain un flot chaud me sortir du sexe, s’étaler dans les draps.

Panique ! Excessif à l’exercice, j’ai abusé et je saigne. Je soulève le drap dans la lueur bleuâtre des veilleuses du dortoir et que vois-je : un liquide tout blanc. Là, comme je suis très intelligent, j’ai un flash et je comprends d’emblée que c’est avec ça qu’on fait les bébés. En journée, et dans le même collège, les branlettes étaient plus intellectuelles avec les rédactions. Allez-savoir pourquoi, je prenais toujours d’incroyable chemins de traverse pour traiter le devoir du jour, mais comme j’avais un minimum de style pour vendre ma copie – systématiquement annotée d’un « hors sujet » -, je m’en sortais et sauvais une note honorable en Français.
A partir de là, je me dis : « Ça y est, j’ai trouvé ma vocation, ma mission sur cette terre s’est éclaircie, j’ai touché au mode d’emploi, ma place est toute trouvée, je serai écrivain ! »

Je me souviens d’un débat où j’accompagnais Pierre Desproges ; autre invitée en intervenant: Régine Deforges. Pour remettre en situation, j’évoque d’abord la question que pose à Régine Deforges un type dans le public : « Vous avez fait un best-seller avec votre Bicyclette bleue… un best-seller commence (dans les années 80, plus maintenant) à 100 000 exemplaires, mais je crois savoir que vous en avez vendu un peu plus que ça…
– Oui, dit simplement Régine Deforges.
– 500 000 ? insiste le gars.
– Un peu plus, dit Régine.
– 1 million !? dit le gars étonné.
– Un peu plus sourit Deforges.
– 2 !?
– Un peu plus…
– 3 millions !? dit le type sidéré.
– Non, clôt Régine Deforges, pas 3 mais 6 millions… toutes éditions confondues bien sûr… »
Je me souviens de la question suivante car la réponse m’a bien plu.

« Madame Deforges, peut-on devenir célèbre en étant écrivain ?
– Oui, on peut devenir célèbre en étant écrivain… mais si je peux vous donner un conseil, arrangez vous pour être célèbre avant. »

Arrivé en fin de troisième dans mes études, je me dis que je vais faire une seconde pour, peut-être ensuite, m’essayer au journalisme. Malheureusement, il va y avoir les chausse-trappes du jeu : en l’occurrence ma mère est pragmatique et amoureuse de Pierre Fresnay. Pragmatique, elle estime que journaliste n’est pas un vrai métier (on en reparlera un peu plus loin) et quant à Pierre Fresnay, elle l’a notamment adoré dans un film, L’Homme aux clés d’or, où il joue le rôle de concierge d’un palace et gagne plein de fric. Ça, outre Fresnay, ma pragmatique avait bien retenu. D’où le fait qu’elle me dirige non pas vers la suite de mes études mais vers une école hôtelière. Et moi, comme un couillon, mou, pas déterminé, je me laisse faire. Vous comprenez pourquoi je me méfie de moi-même ?
A propos du métier de journaliste, ne manquons pas de passer par là sans s’y arrêter un instant : un journaliste italien star disait la chose suivante : « Le métier de journaliste est dur, épuisant, ingrat, sans garantie réelle d’emploi, parfois même dangereux, mais bon… c’est quand même mieux que de travailler. » (NB : C’est Philippe Val qui m’a reprécisé l’auteur du mot en question, « le journaliste star italien », le hasard fait que, au même moment, il resservait cette même citation dans un bouquin qu’il est en train d’écrire ; on a pas mal de références en commun avec Philippe.)
Les journalistes ne bossent pas ? Certains oui, mais à écouter les news, d’où qu’elles viennent, à les décoder, on sent bien que c’est pas le plus grand nombre.
On va pas faire long ici sur ma carrière car il y a tout le présent site Otium pour la raconter, mais passés les deux ans d’école hôtelière et les deux ans dans un quatre étoiles parisien, quatre ans à jouer les larbins, il m’aura fallu une certaine détermination pour redresser la barre que ma mère avait ingénument foutue de travers.

Les quarante ans qui ont suivis m’ont vu jouer des coudes pour me rapprocher de l’écriture ; j’ai d’abord fait dans la production de spectacles, ensuite dans la production télé, des univers mitoyens de l’écrit, où, pris toutefois par les nécessités alimentaires, les miennes et celles de ma famille, je n’ai accouché au final que d’une maigre manne littéraire.
Mais malgré la dictature du quotidien qui m’a bouffé comme elle bouffe tout le monde, le désir d’écrire ne m’a jamais quitté. Cette pulsion, consciente, est pour moi comme une arche longue dans un scénario. Qu’est-ce qu’une arche longue ? pour ceux qui n’y connaissent rien en construction dramaturgique. Une arche longue est le but qu’au final doit atteindre le protagoniste d’une fiction, c’est la situation ultime vers laquelle il tend, elle est meublée d’arches courtes soit de x événements l’embarquant théoriquement jusqu’au but prédéfini par son arche longue.


« Mais pourquoi cette prédestination ? » me direz-vous, comme j’ai pu mille fois me le dire à moi-même. Pourquoi ce combat quichottesque contre des moulins à vent alors qu’on est si bien dans un hamac à lire le dernier Harlan Coben ? Ne se monte-t-on pas le bourrichon ? Ne me suis-je pas auto-persuadé de cette nécessité d’écriture, et ce fort d’un vague talent pour l’écrit ?
J’ai eu une caméra pour mon treizième anniversaire, une Super 8. A partir de là et dans les cinquante ans qui ont suivis, j’ai constamment engrangé de l’image, tout comme je faisais du son. Et des photos, comme tout un chacun. Ma particularité, c’est que je thésaurise savamment toute cette masse pour en faire quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas du tout au moment où je sauvegarde, la réponse ne vient que bien plus tard. A un moment donné, trop tardivement je trouve, je m’autorise à avoir du temps. A partir de là, j’observe ma corbeille de souvenirs qui est fort pleine et je mets à la ranger, numérisation (200 heures de vidéo, 50 heures de son), scannage (10 000 photos) et je scripte tout ça, fabrique une très grosse base de données car, c’est bien beau d’avoir des infos mais si tu sais pas les retrouver, t’as l’air con du KGB à l’issue de la guerre froide.

Vous connaissez les deux versions du Renseignement durant la guerre froide ? D’un côté tu as les 100 000 agents de la CIA, de l’autre les 400 000 agents du KGB. Mécaniquement, le KGB engrange 4 fois plus de renseignements que la CIA, sauf que l’Amérique est en avance en informatique et va donc s’ingénier à classer tous ces millions de petites infos via ses ordinateurs, alors que le KGB, débordé par la masse, va stocker ses données dans d’immenses hangars ressemblant à celui où l’on paume l’Arche à la fin des Aventuriers de l’Arche Perdue. Moralité : c’est bien beau de ranger mais si derrière tu ne sais plus ce que tu as rangé, et où…
Tout ça pour dire que j’ai de la suite dans les idées, une détermination, et c’est d’ailleurs ce qui nous vaut d’avoir ici un roman-photo.
Auto-persuasion pour l’écriture ? Peut-être mais je ne suis pas sûr. Ça tient plutôt du… magique – j’aime pas l’idée car je suis un plutôt rationnel -, du magique et du malaise. Magique car, quand j’écris, je pars avec une idée, un axe, c’est préférable pour moi que de partir à l’aveuglette, mais, en cours d’exercice, au clavier, j’ai tendance à quitter mes rails, une idée en bousculant une l’autre, je pars en digression et, en même temps, j’ai l’impression que les mots ne sont plus les miens mais qu’ils m’arrivent d’ailleurs, d’outre quelque chose, de derrière la tête. Un peu schizo, le mec, non ? Ça, c’est quand tout va bien, qu’il est en forme pour écrire. Parce qu’autrement, il y a le malaise. Le malaise quand ça vient pas, ou quand ça vient en merdasse. Tu le sens, t’es pas content. Malaise aussi et surtout quand t’écris pas. Un sentiment de défaut, de manque, quand l’ennui, la faiblesse, le manque d’énergie et/ou de courage te coupe les pattes et que tu ne fais pas ce qu’il convient de faire, soit ta prédestination.
Et on rejoint ici l’aspect schizo, soit l’autre derrière toi qui lui est prêt à écrire alors que toi tu rechignes, l’autre qui donc te fout des coups de pieds au cul pour que tu t’y mettes.
Tout ça pour donner du sens à la vie alors qu’on sait pertinemment qu’elle n’en a pas. J’envie ceux qui sont prédestinés à lire Harlan Coben et à qui la vie offre un hamac

Coming next : Rabâchage, forcément rabâchage
